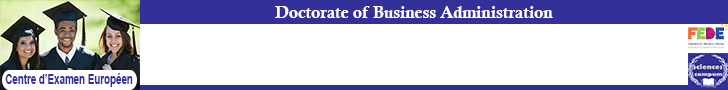Les fonds de pension : une finance de retraités ?
Souvent perçus comme les monstres froids du capitalisme financier, les fonds de pension auraient pourtant de quoi rassurer. Ne sont-ils pas de simples caisses de retraités (pension signifie retraite en anglais) ? Ils gèrent certes une modalité particulière, souvent décriée en Europe, la retraite par capitalisation*. Apparus à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, les fonds de pension font fructifier les cotisations des employeurs et de leurs salariés en les plaçant sur les marchés financiers. Régis par le régime juridique du trust, ils sont censés agir pour le seul bénéfice des salariés, en garantissant dans les meilleures conditions leurs prestations de retraite future. Mais depuis que ces fonds ont pris leur essor durant l’après-guerre, il est arrivé que les retraités ne voient jamais la couleur de leur retraite, parce que leur entreprise fermait arbitrairement le fonds, ou utilisait les capitaux accumulés pour ses propres besoins. Aux États-Unis, la loi Erisa de 1974 a tenté de contenir ces dérives. Mais elle a levé l’obligation pour les fonds de pension de garantir le niveau des retraites futures, ce qui équivaut à reporter tous les risques sur les salariés. La loi a également autorisé les fonds de pension à investir dans tous les actifs, aussi risqués soient-ils. Après les junk bonds (obligations* à haut rendement mais à haut risque) dans les années 1970-1980, ils ont, dans les années 2000, acquis abondamment les fameux CDO (collateralized debt obligation) qui ont joué un rôle notable pendant la crise financière de 2008. Les plus gros fonds de pensions n’en restent pas moins des fonds publics américains, comme le CalPERS, la caisse de retraite des fonctionnaires californiens, qui garantissent toujours un niveau de versements futurs à leurs bénéficiaires. L’Angleterre, les Pays-Bas et plus récemment l’Allemagne ont également favorisé leur essor. En France, en revanche, l’épargne retraite est plutôt gérée par des sociétés d’assurance et des banques.
Avec une capitalisation estimée à 26 000 milliards de dollars, les fonds de pension constituent les acteurs majeurs des marchés financiers globaux. Selon la vision traditionnelle, leur statut de gérants d’épargne retraite, caractérisée par un horizon « long », favorise des placements eux aussi orientés vers le rendement à long terme. L’expertise de leurs analystes financiers leur permettrait de prendre leur décision d’investissement en fonction du potentiel de rendement des entreprises, plutôt que de suivre aveuglément les humeurs du marché. Des économistes comme Patrick Arthus rappellent cependant que, étant soumis à la forte concurrence des autres fonds et évalués à une fréquence régulière (souvent trimestrielle), les gestionnaires de fonds de pension sont contraints à une logique de rendement à court terme. Cela les incite à réaménager fréquemment leur portefeuille en se pliant à l’« opinion du marché ». D’où des comportements aussi moutonniers que les autres investisseurs.
Les hedge funds : des investisseurs sulfureux
« Toujours battre le marché » : telle aurait pu être la devise d’Alfred W. Jones. L’inventeur des hedge funds, ces sociétés d’investissement privées qui gèrent le capital de quelques gros épargnants, mettait un point d’honneur à obtenir des rendements supérieurs à ceux des autres opérateurs. Mise au point dans les années 1940, sa méthode consistait à miser sur quelques entreprises triées sur le volet (« asset picking »), et à couvrir sa position en vendant des titres qu’il s’engageait à racheter ultérieurement (« vente à découvert »). En cas de hausse des cours, la sélection des titres lui laissait espérer une progression supérieure à celle du marché. En cas de baisse, il engrangeait de toute façon un profit grâce à la vente à découvert. Bref, une véritable martingale, dont il démultipliait les bénéfices en recourant largement au crédit (l’« effet de levier » de la dette). La méthode paie. A.W. Jones parvient à dégager des rendements supérieurs de 40 % à ceux de ses concurrents ! De quoi susciter les vocations… Les hedge funds s’installent durablement dans le paysage américain de l’après-guerre.
Nouvel âge d’or dans les années 2000. Profitant de la libéralisation financière des années 1980-1990, ils sont devenus des investisseurs très pointus, maîtrisant sur le bout des doigts les produits dérivés* comme les futures (paris sur la valeur future d’une devise, d’un titre ou d’un indice de titres), se livrent à des stratégies d’arbitrage (déceler et profiter d’un écart de rendement injustifié entre deux types de titres) ou interviennent sur des marchés spécifiques, comme ceux des « pays émergents ». Leur spécialisation et leurs promesses de rendement leur valent de trouver une clientèle fournie auprès d’investisseurs plus classiques, des banques aux fonds de pension en passant par les fonds souverains.
Souvent domiciliés dans des paradis fiscaux, bénéficiant d’une réglementation fort lâche, les hedge funds peuvent recourir largement au levier de l’endettement. Or si ce dernier dope les profits lorsque le pari est gagné, il peut occasionner des pertes colossales dans le cas contraire. La prise de risque excessive est une critique récurrente adressée au hedge funds, dont les modèles mathématiques négligent souvent la probabilité d’un effondrement du marché, comme en 2008. Leurs profits les plus spectaculaires ont parfois été réalisés dans des conditions troubles. Ainsi, en 1993, le financier hongrois George Soros lança une véritable offensive contre la livre sterling. Il consacra non seulement 15 milliards de dollars à vendre de la livre contre du mark allemand, mais se débrouilla pour le faire savoir, afin d’entraîner le marché derrière lui…, et de précipiter effectivement la chute de la devise britannique. Ce qui lui permit d’empocher un milliard de dollars. Les hedge funds s’emploient ainsi parfois à déstabiliser délibérément un marché pour dégager un profit. De quoi nourrir leur réputation sulfureuse.
Fonds souverains : les puissances financières du Sud
Armés par la puissance de frappe financière des monarchies pétrolières du Moyen-Orient ou des tigres asiatiques, on dépeint souvent les fonds souverains à l’assaut des places financières globales. Ces fonds d’investissements ont pour spécificité de gérer l’épargne des États auxquels ils appartiennent (d’où le qualificatif de « souverains »). Une épargne souvent issue de la manne pétrolière, comme en témoigne la présence de l’Abou Dhabi Investment Authority (ADIA, 875 milliards de dollars à lui seul), de la Kuweit Investment Authority (KIA) ou encore du Government Pension-Fund Global norvégien (adossé au pétrole de la mer du Nord) parmi les sept plus gros fonds souverains mondiaux. Si le KIA ouvre le bal dès 1953, c’est avec les chocs pétroliers de 1973 et 1979 que les fonds souverains moyen-orientaux deviennent des acteurs majeurs de la finance globale. Chargés de stabiliser les revenus des pays exportateurs face à la volatilité des prix des hydrocarburants, mais aussi de constituer une épargne disponible à l’avenir, ils recyclent la rente pétrolière en la plaçant sur les marchés financiers internationaux.
Alors qu’ils engrangent des excédents commerciaux, les pays émergents asiatiques leur emboîtent le pas dans les années 1980-1990. Accumulant à partir des années 2000 de gigantesques réserves en dollars (elles seraient passées de 15 milliards en 1994 à 18 000 milliards aujourd’hui), la Chine crée le China Investment Corporation (CIC, 200 milliards de dollars) en 2007. Le pays est aujourd’hui le premier détenteur de bons du Trésor américains, à hauteur de 585 milliards de dollars. Un chiffre impressionnant qui, associé à quelques opérations spectaculaires (comme l’achat en 2007 de 20 % du London Stock Exchange, la Bourse de Londres, par le Qatar Investment Authority), alimente tous les fantasmes. Ces puissances financières du Sud apparaissent tantôt comme des prédateurs, avides de faire main basse sur les actifs occidentaux, tantôt comme des acteurs qui pourraient stabiliser les marchés. Il est vrai que les fonds souverains ont généralement des stratégies d’investissement à long terme, axés pour une grande part sur l’acquisition de bons du Trésor ou de participations minoritaires dans le capital d’entreprises occidentales. Cela ne les empêche pas de réaménager leur portefeuille en fonction des tendances du marché, ou de succomber autant qu’à leur tour aux promesses de rendements exceptionnels deshedge funds.
Les banques : plaque tournante de la finance
En apprenant les agissements de Jérôme Kerviel, ce trader de la Société générale qui a fait perdre à sa société la bagatelle de 5 milliards d’euros début 2008, le grand public a découvert un visage méconnu des banques. Ces institutions auxquelles tout un chacun a recours pour percevoir son salaire et régler ses factures figurent aujourd’hui parmi les acteurs majeurs des marchés financiers. Le travail de J. Kerviel consistait à intervenir sur un marché à terme, en l’occurrence parier sur la valeur future d’un indice d’actions*, ce qui est ni plus ni moins qu’une activité de spéculation.
Les banques commerciales comme la Société générale (à distinguer des banques d’investissement comme Goldman Sachs) n’ont pas toujours été aux premières loges de la finance de marché. Bien au contraire. Les marchés financiers organisent la confrontation directe entre les épargnants et les entreprises : ils permettent aux premiers de financer les secondes en achetant les actions ou les obligations* qu’elles émettent. Les banques, elles, sont traditionnellement des intermédiaires. Leur rôle consiste à transformer les dépôts de leurs clients en crédits à plus ou moins long terme aux entreprises (et dans une moindre mesure aux ménages).
L’essor de la finance de marché, à partir des années 1980 en Europe continentale, semblait devoir réduire les prérogatives des banques commerciales. Ce n’est pas ce qui s’est produit. Profitant du décloisonnement de la finance, elles ont diversifié leurs activités, entrant de plain-pied dans celles du courtage et de la gestion de portefeuille. Alors que les fonds communs de placement, l’épargne retraite et l’assurance vie, sont encouragés par les États, les banques prennent leur part du gâteau. En 2000, les dix premiers gestionnaires de placement européens étaient des banques. On retrouvait parmi elles la Deutsche Bank, l’Union des banques suisses (UBS) et… la Société générale.
Mais les banques entretiennent des relations organiques avec d’autres intervenants, comme les hedge funds. Elles en sont des clientes, mais elles financent aussi leurs opérations. Que ce soit par le biais de crédits ou de locations de titres (grâce auxquels un hedge fund peut effectuer une opération sur des actifs qu’il ne possède pas), elles leur fournissent le nerf de la guerre. C’est pourquoi les paniques boursières entraînent rapidement les banques dans la tourmente. Plaque tournante de la finance, elles en enregistrent tous les soubresauts.
Assurances : la bourse ou la vie
La première mission des sociétés d’assurance consiste à indemniser leurs clients pour les risques couverts par leur police, du dégât des eaux à l’accident de train en passant par le vol de voiture. Dans ce registre, les cotisations qu’elles reçoivent, calculées en fonction des probabilités de sinistre, compensent à peu de chose près les sommes qu’elles versent à leurs assurés. Pas de marge de manœuvre de ce côté pour intervenir sur les marchés boursiers. Ces entreprises interviennent cependant dans d’autres domaines qui eux s’y prêtent au contraire fort bien, ceux de l’assurance vie et de l’épargne retraite.
Dans ce registre-ci, l’activité des assurances s’apparente à celle des fonds de pension. Elles recueillent une épargne placée à long terme, qu’elles sont chargées de gérer afin d’en tirer le meilleur rendement. Parvenu au terme de l’échéance de son contrat d’assurance vie, leur client se verra verser soit un capital augmenté, soit une rente indexée sur le rendement annuel de ce capital. Pour y parvenir, les assurances placent les sommes qui leur sont confiées en actions* ou en obligations*. La capitalisation boursière des assurances est particulièrement importante aux Royaume-Uni, où elle représentait plus de 60 % du PIB pour l’activité épargne retraite et 30 % pour l’activité assurance vie. En France, la capitalisation boursière de l’assurance vie constituait plus de 40 % du PIB au début des années 2000, alors que l’épargne retraite dépassait à peine 3 % du PIB.
L’essor de la finance de marché
L’essor de la finance de marché trouve plusieurs explications.
Les chocs pétroliers de 1973 et 1979. La multiplication par quatre du prix du baril de pétrole en 1973 a pour effet d’accroître brutalement les revenus des pays exportateurs tout en augmentant le déficit commercial des pays importateurs. Parmi les premiers, les monarchies du Moyen-Orient, peu peuplées, ne sauraient absorber cette masse de devises et cherchent à la recycler sur les marchés financiers internationaux. Les seconds, États-Unis en tête, ont besoin de financer leurs importations. Cette situation accélère la création de marchés financiers intégrés à l’échelle planétaire.
La libéralisation de la finance. Les années 1980 marquent le vrai point de départ des trois « D » de la libéralisation de la finance : décloisonnement, désintermédiation, déréglementation.
• Décloisonnement : les États mettent fin à la séparation stricte des institutions financières, notamment entre banques de dépôts et banques d’investissement. Désormais, les premières pourront investir sur les marchés financiers.
• Désintermédiation : délaissant les intermédiaires bancaires, les entreprises recourent aux marchés financiers pour capter l’épargne des ménages (finance directe).
• Déréglementation : les restrictions à la circulation internationales des capitaux sont levées.
Une dette publique croissante. Dès les années 1970, la mécanique financière des États providence se grippe. Une croissance en berne grève les recettes fiscales, alors que la crise dope les dépenses de protection sociale (santé, indemnisation chômage). Les États financent leurs déficits en émettant des obligations sur les marchés financiers. Ils incitent les ménages à acquérir des titres de la dette publique (bons du trésor ou obligations d’État) grâce à une fiscalité favorable aux produits d’épargne financière à destination des ménages : assurance vie, plan épargne retraite, sicav…
Les innovations financières. Parmi celles-ci, la création des organismes de placement commun de valeurs mobilières (OPCVM) joue un rôle décisif pour canaliser l’épargne des ménages vers les marchés financiers. Les OPCVM ont pour les épargnants l’intérêt de mutualiser les risques en leur permettant d’acquérir une part d’un portefeuille diversifié, plutôt que de placer leur épargne dans l’acquisition d’un seul titre.
La crise financière de 2007-2008
Le krach financier de 2008 trouve son origine dans une crise du crédit immobilier américain.
Plus précisément dans l’insolvabilité de centaines de milliers de familles modestes qui avaient bénéficié de prêts risqués (les fameux crédits subprime). La genèse de cette crise et surtout sa diffusion à l’ensemble de la planète ont cependant reposé sur l’existence de chaînes de financement complexes.
Il a d’abord fallu que les liquidités deviennent suffisamment abondantes pour inciter les banques à accorder des crédits immobiliers à des familles qui ne pouvaient jusque-là y prétendre. Une innovation financière a joué un rôle capital : la titrisation des crédits immobiliers. Les banques cédaient leurs créances à des sociétés (les SIV oustructured investment vehicle) qui émettaient des titres en contrepartie (les CDO,collateralized debt obligations). Les créances immobilières sortaient ainsi du bilan des banques, ce qui leur permettait d’accorder de nouveaux crédits.
Cela supposait que des investisseurs se portent acquéreurs de ces titres. Les fonds de pension, les fonds souverains, les banques en ont souscrit une part. Mais les hedge funds se sont taillé la part du lion : au moment du déclenchement de la crise, ils détenaient à eux seuls 46 % des CDO et 80 % des tranches les plus risquées (« equity »), acquis avec un fort levier d’endettement. Ce rôle éminent ne saurait faire oublier que les hedge funds agissaient comme des intermédiaires, gérant une épargne confiée par des fonds de pension, des fonds souverains et des banques commerciales.
L’effondrement du cours des CDO a obligé l’ensemble des investisseurs à vendre d’autres titres pour préserver leur liquidité, ce qui a propagé la crise aux marchés boursiers. Les hedge funds ont joué un rôle décisif dans cette contagion en raison de leur endettement auprès des banques. Face à l’effondrement de la valeur des CDO, ils ont dû vendre en détresse des actions* afin d’honorer leurs dettes, contribuant à la chute des cours boursiers. Percevant un important risque de défaut, les banques ont alors exigé des versements supplémentaires (appels de marge), ce qui a obligé leshedge funds à poursuivre la vente de titres… La chute cumulative des cours a mis en péril le système tout entier.